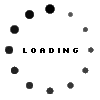Les situations d’urgence, qu’elles soient liées à des catastrophes naturelles, conflits ou pandémies, accentuent souvent, les inégalités de genre et affectent l’accès équitable aux soins de santé, essentiels. La sensibilisation par les médias est cruciale pour mettre en lumière ces défis, informer le public et influencer les politiques publiques. D’où la rencontre d’échanges avec des journalistes et communicateurs, ce jeudi 25 juin 2025, à Ouagadougou.
La rencontre du jour portant sur les différentes inégalités de genre et d’accès à la santé dans les réponses d’urgence, entre en droite ligne du projet « Droit accès à la santé Nord Burkina » mis en œuvre à Kongoussi grâce au financement de Médecin du Monde au Burkina (MdM). Organisé par la Communauté d’Action pour la Promotion de la Santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF), l’atelier a réuni une quinzaine de participants, à Ouagadougou. Le but est d’améliorer l’environnement sanitaire, social, communautaire et politique en faveur du droit à la santé, en particulier des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité des genres, pour les femmes et les adolescentes touchées par le conflit au nord du Burkina Faso.
L’atelier a été assuré par une personne ressource du droit burkinabè. Awa Yanogo Somé, la facilitatrice a présenté dans quel contexte, les gens sont en situation d’inégalités de genre, comment travailler à pouvoir quitter cette inégalité surtout, les populations déplacées internes. Pour le deuxième module, il s’est agi de revenir un peu sur les crises humanitaires au niveau national et mondial.

« Au Burkina Faso, nous vivons cette situation depuis 2016. Avec l’insécurité, on a eu beaucoup de déplacés internes. On a fait un peu le récapitulatif de ce que vivent ces personnes et on a mis l’accent sur les femmes et les filles parce que ce sont vraiment, les personnes qui ont besoin de soins en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce n’est pas pour dire que les autres n’en n’ont pas besoin. Mais, dans notre stratégie, ce sont des personnes très vulnérables et très susceptibles. Donc, il faut vraiment prendre en charge rapidement, les questions de santé sexuelle et reproductive et leur offrir tout le service nécessaire et adéquat pour qu’elles puissent être épanouies », a-t-elle expliqué
Impact de la crise sécuritaire et humanitaires sur les femmes et les filles
Des recherches menées dans le monde entier ont montré que les femmes et les filles touchées par un conflit et déplacées courent un risque accru de viol et violence sexuelle, de mariage précoce, de mariage d’enfant, de mariage forcé, de trafic d’êtres humains, de grossesse non désirée, d’avortement dangereux et de complications pendant la grossesse et l’accouchement.
Lire aussi : Inégalités en Afrique : Oxfam tire la sonnette d’alarme
Aussi, dans toute population touchée par une crise, environ 4 % de la population totale sera enceinte, à tout moment. Parmi ces femmes et ces filles enceintes, environ 15 % présenteront une complication obstétrique, comme une obstruction ou un accouchement prolongé, une pré-éclampsie/éclampsie, une infection ou un saignement grave.
L’OMS estime que 9 % à 15 % des nouveau-nés nécessiteront des soins d’urgence vitaux (IAFM 2018). Le premier jour de vie présente le risque le plus élevé pour les nouveau-nés.
Rôle des médias dans la protection de la santé en période de crise humanitaire
Dans la gestion des crises humanitaires et sanitaires, les médias jouent un rôle vital en informant les populations sur les risques, en diffusant des conseils de protection et en orientant vers les services d’aide, tout en luttant contre la désinformation.
Ils servent de canal de communication fiable entre les autorités, les humanitaires et le public, favorisent la participation citoyenne et la résilience communautaire face aux crises futures.
« Notre objectif est que les journalistes puissent être nos relais auprès de la communauté. Nous sommes convaincus qu’ils vont vraiment nous aider, à atteindre ces objectifs », a déclaré Maria Nonguierma, présidente de la CAPSSR.
L’atelier a permis de renforcer les capacités des participants qui se disent prêts à faire passer le message de sensibilisation.
Françoise Tougry