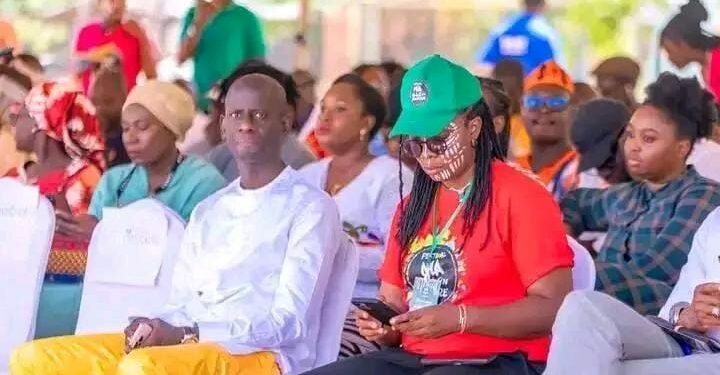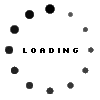Au cœur du colloque international placé sous le thème « Représentation identitaire et expressions culturelles dans les arts dramatiques », la communication de Dr Nongzanga Joséline Yaméogo, enseignante-chercheure à l’Université Yembila Abdoulaye Toguyeni de Fada N’Gourma, a marqué les esprits. Avec passion et rigueur, elle a exploré un sujet essentiel : « La contribution du théâtre d’auteurs burkinabè à la souveraineté culturelle ».
Face à la mondialisation culturelle et à la menace d’une uniformisation des imaginaires, Dr Yaméogo pose une question fondamentale. Comment les créateurs burkinabè peuvent-ils défendre et affirmer leurs identités singulières ?
Sa réponse est claire : le théâtre d’auteur au Burkina Faso est un acte de souveraineté. Par l’écriture, la mise en scène et la parole dramatique, les dramaturges nationaux construisent une mémoire collective et affirment la légitimité d’un regard africain sur le monde.
Deux œuvres emblématiques à l’étude
Pour appuyer son propos, la chercheuse s’est appuyée sur une analyse qualitative de deux pièces majeures. Le Fou de Jean-Pierre Guingané et les Voies du silence de Prosper Compaoré. Deux textes qui, malgré les années, demeurent d’une brûlante actualité.
Dans « Le Fou », Guingané dépeint la tragédie d’un père broyé par la corruption et les désillusions d’un système social en déliquescence. Le fou, y devient la voix de la vérité, celle qui refuse le mensonge et rétablit la mémoire collective.
Quant à « Les Voies du silence », Compaoré dresse le portrait d’une société fracturée entre riches et exclus. Là, le fils d’un homme politique riche violera la fille d’un exclu. À partir de cet instant, l’auteur questionne la justice, le pouvoir et le silence complice d’une société gangrenée par l’impunité.
Lire aussi Ouverture du Colloque international de la Nuit des Lompolo 2025 : Les arts dramatiques au cœur de l’identité culturelle
Des analyses de ces deux œuvres théâtrales, Dr Yaméogo dégage trois axes majeurs de la souveraineté culturelle. La souveraineté narrative où les dramaturges refusent de se soumettre aux récits imposés de l’extérieur. Ils reprennent la parole pour raconter leur propre histoire, selon leurs codes et leur mémoire.
Dans la souveraineté politique, le théâtre devient un contre-pouvoir. En dénonçant la corruption, l’autocratie ou les injustices, il offre un espace où la vérité trouve refuge.
Enfin, l’autonomie culturelle où les auteurs burkinabè forgent un capital symbolique endogène en valorisant les formes locales, à savoir l’oralité, les proverbes, les chants, les danses et les percussions. Ces éléments ne sont pas de simples ornements, mais des choix esthétiques porteurs d’une vision du monde.
En conclusion, Dr Yaméogo souligne que le théâtre burkinabè d’auteur a réussi un véritable « coup de force stratégique ». Il s’agit de la création d’un champ culturel autonome, affranchi des modèles dominants. Selon elle, le message essentiel de la communication est la suivante : l’affirmation identitaire est avant tout l’acte de produire sa propre légitimité. Ainsi, le théâtre devient non seulement un art de représentation, mais aussi un moteur de développement et d’émancipation nationale.
Cette communication, nourrie de références théoriques et d’une lecture sensible des textes, a été saluée par les participants du colloque. Elle rappelle, avec force, que la culture n’est pas un simple héritage, mais un combat quotidien pour la dignité et la souveraineté des peuples.
Fabrice Sandwidi
Queenmafa.net