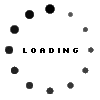La communauté internationale commémore ce 31 octobre 2025 le 25e anniversaire de la Résolution 1325 de l’ ONU. L’adoption de cette résolution implique que chaque pays élabore et mette en œuvre un plan d’action national (PAN) périodique. Afin d’en savoir davantage sur les enjeux de cet engagement pour le Burkina Faso, Queen Mafa a tendu son micro, Dr Nessenindoa Julienne GUE. Sociologue, et chercheure bien avertie de la question, Dr GUE a occupé de nombreux postes de responsabilité au Burkina Faso, notamment celui de Directrice générale Femmes, Paix et Sécurité, de Conseillère technique du Ministre de la recherche scientifique et de l’innovation (ex MRSI) et de Maire de la Commune de Pouni (Région de Nando, Province Sanguié). Elle a coordonné plusieurs projets dont un en cours portant sur la promotion de l’approche « Cercle de Paix » pour transformer les conflits.
Dans cet entretien, l’experte en genre, paix et sécurité jette un regard sur les défis majeurs de la mise œuvre de la R.1325, la féminisation de la violence et propose des leviers stratégiques pour transformer les engagements en résultats concrets pour les communes et les régions du Burkina Faso.
Queen Mafa: Selon vous qu’est-ce justifie l’adoption la Résolution 1325 ?
Dr Nessenindoa Julienne GUE: Avant tout propos, permettez-moi d’exprimer mon enthousiasme et ma gratitude à votre endroit, pour le micro que vous me tendez en ce jour où le monde entier fête le 25ième anniversaire de la Résolution 1325, 25 ans marquant un quart de siècle de son adoption. C’est pourquoi le thème de cette année est consacré au bilan, défis et perspectives.
La Résolution 1325, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 31 octobre 2000, est une réponse à la faible efficacité des résolutions 1265 (en 1999) et 1296 (en 2000) qui étaient centrées sur la protection des civils dans les conflits armés, sans prendre en compte les questions spécifiques des groupes vulnérables (femmes/filles, enfants). Elle marque la reconnaissance mondiale de l’impact différencié des conflits sur les femmes et les filles, du leadership des femmes (mère, épouse, fille, sœur, nièce, belle-fille) et de leur remarquable rôle dans la prévention, le règlement des crises et la consolidation de la paix.
Mais face à la recrudescence des actes de violences, de terrorisme et d’extrémisme violent impactant de plus en plus les femmes et les jeunes, dix (10) autres résolutions (1820, adoptée le 09 juin 2006, 1888 en 2009, 1889 en 2009, 1960 en 2010, 2106 en 2013, 2122 en 2013, 2242 en 2015, 2467 en 2019, 2493 en 2019 et 2538 en 2020), ont été adoptées pour renforcer la Résolution principale qu’est la 1325.On peut aussi rappeler l’adoption de la Résolution 2250 (Jeunesse, Paix et Sécurité), le 09 décembre 2015 en faveur des jeunes et qui s’articule autour des mêmes piliers que la 1325.
Quelle est la différence entre la Résolution 1325 et l’Agenda Femmes Paix et Sécurité ?
C’est l’ensemble de ces onze (11) Résolutions (insistant sur la nécessité que les États prennent des mesures pour l’implication systématique des femmes dans les sphères de décisions pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent), qui forme l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité.
Vous avez été la première Directrice générale Femmes, Paix et Sécurité au Burkina Faso. Qu’est ce qui a pu militer pour la création de cette direction générale selon vous et à votre choix ?
Comme vous le savez, les organigrammes sont proposés par les ministères, mais ils sont amendés et validés en conseil des ministres. La création de l’ancienne Direction générale Femmes, Paix et Sécurité et son redimensionnement actuel en Direction (technique) Femmes, Paix et sécurité, exprime la volonté de l’Etat burkinabè, à implémenter l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité pour respecter ses engagements. C‘est une réponse institutionnelle des autorités face à la complexité des conséquences de la crise sécuritaire et le basculement de plus en plus noté des femmes dans les unités combattantes terroristes (féminisation de la violence).
Par ailleurs, le profil de Madame la Ministre Salimata NEBIE/CONOMBO, experte en Genre, Paix et Sécurité, ancienne stagiaire de l’École de maintien de la Paix à Bamako au Mali, alors ministre du genre et de la famille, a pu être déterminant dans la proposition de création de cette structure.
En juin 2018, seuls 23 États membres africains avaient adopté ou entamé l’élaboration d’un Plan d'action national dont le Burkina Faso (ONU-Femmes, 2024Quels sont, selon vous, les acquis majeurs de la mise en œuvre de la Résolution 1325 au Burkina Faso et dans la sous-région ?
Le Burkina Faso est en train de mettre en œuvre la troisième génération de Plan d’action de mise en œuvre de la Résolution 1325. Contrairement aux deux premiers plans, le Plan national intégré de mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (PANI 2023-2025) prend en compte l’Agenda (avec les onze résolutions le composant).
En juin 2018, seuls 23 États membres africains avaient adopté ou entamé l’élaboration d’un Plan d’action national dont le Burkina Faso (ONU-Femmes, 2024). En 2023, 95 pays dans le monde ont mis en place des plans d’action nationaux (PAN) au titre de la résolution 1325. Dans le but de motiver les pays à implémenter l’Agenda FPS en Afrique, le cadre continental de suivi des résultats a été institué (impliquant l’élaboration de rapports réguliers et systématiques sur la mise en œuvre de l’Agenda.
Notre pays est donc à féliciter car faisant parti des pionniers en Afrique et même dans le monde en la matière d’implémentation de la résolution 1325.
N’ayant pas de données sur l’évaluation du PANI (2023-2025) dont l’échéance est pour décembre 2025, il m’est difficile de répondre à cette question. Cependant, il convient de noter les actions menées par le ministère en charge du genre et des organisations féminines de la société civile sur le terrain. En effet, des projets et des actions sont en cours sous l’égide du gouvernement et de ses partenaires au développement, notamment certaines organisations internationales, continentales, nationales et locales et qui contribuent fortement à la mise en œuvre dudit Agenda.
Le grand challenge reste la coordination et la capitalisation de ces actions.
Ma plus grande satisfaction a été la concrétisation du contrat d’objectif de Madame la Ministre NEBIE qui était l’élaboration du 3ième Plan d’action de mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et SécuritéQuels ont été les moments les plus marquants et les plus difficiles dans l’exercice de votre fonction ?
Le Burkina Faso est l’un des rares pays à avoir créer une entité institutionnelle qu’est la Direction (générale) Femmes, Paix et Sécurité, comme une preuve de sa forte volonté de reconnaître et de promouvoir le rôle central joué par les femmes, en tant qu’agentes de l’édification de la paix et de la sécurité et de principales victimes subissant de façon directe ou indirecte, les impacts négatifs des conflits, de plus en plus armés.
J’étais alors enthousiaste et reconnaissante pour le choix de ma modeste personne, pour assoir les bases de cette nouvelle direction générale dont l’objectif principale était « d’assurer la promotion et le soutien de la participation de la femme et de la jeune fille à la construction de la paix, la stabilité et au renforcement de la sécurité ».
Nous avons été contactés par plusieurs structures onusiennes, internationales et continentales qui voulaient collaborer avec nous. Nous étions invitées aux USA où il était prévu de rencontrer des partenaires techniques et financiers.
Ma plus grande satisfaction a été la concrétisation du contrat d’objectif de Madame la Ministre NEBIE qui était l’élaboration du 3ième Plan d’action de mise en œuvre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. La Direction générale a été opérationnelle après ma nomination en août 2022 et celles des directrices et directeur technique (en septembre), même sans ligne budgétaire propre. Le PANI a été élaboré par un comité interinstitutionnel ayant fortement associé des structures publiques, privées et surtout les organisations féminines de la société civile burkinabè, grâce aux appuis financiers et techniques de partenaires dont le PNUD et InterPeace.
La plus grande difficulté était d’ordre financier : sans argent, il était difficile d’engager certaines activités.
Je ne suis plus à ce poste de Directrice générale (qui n’existe plus d’ailleurs), mais je me réjouis de l’existence d’une Direction technique pour continuer les missions de l’ex Direction générale.
Au regard de votre expertise, comment continuez vous à apporter votre contribution à l’édification de la paix et la mise en œuvre de la 1325 au Burkina Faso ?
Je suis toujours engagée pour cette cause à laquelle je crois fermement. J’ai mené plusieurs études commanditées pas des structures (ISS, OIM, ONU-Femmes, etc.) sur des thématiques en rapport avec l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Je continue de dispenser des formations sur le sujet.
Actuellement, je coordonne un projet qui ambitionne de disséminer l’approche Cercle de Paix (promue au Burkina Faso par l’ONG internationale InterPeace) dans des régions du Burkina Faso.
Quels sont les principaux obstacles qui freinent encore l’application locale de la Résolution 1325 ?
Dans un pays en guerre contre le terrorisme, l’insécurité est le premier obstacle limitant les déplacements et la mise en œuvre des actions.
Les différents Plans d’actions du Burkina Faso ou d’ailleurs souffrent du même problème qui est l’insuffisance des ressources financières pour mettre en œuvre les actions prévues. En effet, l’allocation du budget tient compte des besoins urgents (armements, actions humanitaires, etc.).
Le faible niveau de connaissance de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité est également une contrainte.
Comment faire évoluer les mentalités et les pratiques locales et institutionnelles pour que les femmes participent mieux aux actions visant à gérer les conflits ?
Au niveau local, il existe des mécanismes traditionnels et modernes ou publics, devant faciliter la contribution des femmes en matière de paix et de sécurité. Dans certaines sociétés du Burkina Faso, la tante paternelle, la nièce, les griottes et les forgeronnes (dans les sociétés à castes), jouent un rôle central dans la médiation pour la gestion de certains types de conflits.
A travers le mariage traditionnel, la femme est le symbole du trait d’union entre deux familles ou communautés. C’est pourquoi le dernier conseil donné à une nouvelle mariée est de « ne pas être la lame qui déchire, mais l’aiguille qui coud et soude » (dicton burkinabè)
Il faut donc les identifier et les dynamiser, en impliquant les responsables des communautés locales administrative, religieuses et coutumières.
Il faudrait donc sensibiliser, informer et former les femmes, les hommes et les jeunes sur lesdits Agendas et aider les organisations à avoir des financements.
Enfin, il faut capitaliser et diffuser et valoriser les expériences réussies en matière de participation des femmes dans les processus de règlements des conflits, car susceptibles d’être répliquées ailleurs.
Améliorer le statut social et juridique des femmes et des filles par des mesures ciblées et fortes qui favoriseront leur participation réelle au niveau local.Quels leviers prioritaires faudrait-il activer pour accélérer la mise en œuvre de 1325 dans les communes et régions ?
D’abord, améliorer le statut social et juridique des femmes et des filles par des mesures ciblées et fortes qui favoriseront leur participation réelle au niveau local. Il faut relire et renforcer les lois et textes — notamment les lois relatives aux quotas aux élections et celles contre les violences faites aux femmes — pour les rendre plus dissuasifs.
Ensuite, il faut mettre en place des mécanismes transparents de promotion interne et appliquer la méritocratie tout en fixant des quotas réels dans les postes nominatifs. Aujourd’hui, la représentation des OSC féminines dans les organes législatifs est faible : deux représentantes pour des milliers d’organisations, ce n’est pas suffisant.
Il est également indispensable de lancer des campagnes de sensibilisation contre les préjugés sexistes (les violences verbales sur les réseaux sociaux) pour casser les stéréotypes qui empêchent les femmes d’accéder aux sphères de décision. Parallèlement, former et sensibiliser les leaders coutumiers et religieux sur les droits des femmes peut largement faciliter leur inclusion politique et économique au niveau local.
Sur le plan opérationnel, il faut un financement conséquent pour la mise en œuvre des Plans d’action et des mesures fortes pour l’autonomisation économique des femmes, en impliquant institutions, associations et communautés.
Les OSC doivent aussi développer des approches adaptées pour déconstruire les réticences chez certaines femmes elles‑mêmes à s’engager en politique.
Enfin, organiser régulièrement des séances de formation et d’information sur la vie politique à l’intention des femmes et des filles reste une clé pour renforcer durablement leur participation.
Si vous deviez proposer une mesure phare pour les 5 prochaines années, laquelle recommanderiez-vous ?
Comme le dit si bien ONU-Femmes (2024), les régimes politiques transitionnels, dans des contextes de crise, peuvent offrir des opportunités de refondation et de changements législatifs et structurels pour faire avancer les droits des femmes et des filles.
C’est pourquoi je propose que l’État et les organisations de la société civile proposent de nouvelles lois et des textes d’application incontestables et veiller à leur application effective.
Les actions des partenaires doivent être synergiques, suivies et coordonnées par le ministère en charge du genre, à tous les niveaux pour une bonne capitalisation et un impact positif sur les initiatives femmes.
Entretien exclusif Queen Mafa