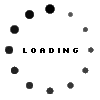Regard sur le Bénin, le Togo et le Burkina Faso.
L’expansion fulgurante du numérique en Afrique de l’Ouest a transformé les modes de communication, d’échange et d’interaction sociale. Si cette révolution technologique offre des opportunités sans précédent pour l’émancipation des femmes, elle a également donné naissance à une nouvelle forme de violence : les cyberviolences basées sur le genre.
Les Violences Basées sur le Genre (VBG) désignent toute forme d’agression ou d’acte préjudiciable commis contre une personne en raison de son genre ou des rôles que la société lui attribue.
Dans ce cadre, la cyberviolence ou les VBG en ligne se réfèrent aux violences basées sur le genre perpétrées à travers les technologies numériques. Elle se distingue de la violence traditionnelle par son vecteur, le numérique, mais elle n’est pas une nouvelle catégorie de violence. Elle utilise des outils en ligne (réseaux sociaux, messageries, plateformes) comme canal d’amplification des formes de violence préexistantes, permettant une diffusion rapide et transfrontalière, ainsi qu’une stigmatisation durable. Les formes courantes sont la cyberintimidation, qui consiste à envoyer des messages intimidants ou menaçants, et le doxing, défini comme la diffusion publique et malveillante de renseignements privés ou de l’identité de la victime, le cyberharcèlement, les moqueries en ligne, etc.
Au Bénin, au Togo et au Burkina Faso, comme dans l’ensemble de la sous-région, les femmes font face à un défi majeur : comment profiter des avantages du numérique tout en se protégeant des agressions virtuelles qui peuvent avoir des conséquences bien réelles sur leur vie quotidienne, leur santé mentale et leur participation à la vie publique ?
Les chiffres parlent !
Les statistiques révèlent l’ampleur inquiétante du phénomène dans la sous-région ouest-africaine.
Selon une étude menée en Afrique centrale et occidentale, 45,5 % des utilisatrices de Facebook et Twitter ont déjà vécu une forme de violence sexiste en utilisant les réseaux sociaux. Cette proportion, proche de la moitié des femmes en ligne, témoigne de la banalisation des agressions numériques.
Ce sondage a mené du 3 janvier 2019 au 9 janvier 2019 sur les plateformes Facebook et Twitter, auprès d’un échantillon de femmes âgées de 18 à 45 ans, utilisatrices de Facebook et Twitter, vivant dans les pays suivants : Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambie, Guinée Conakry, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo, République Démocratique du Congo (RDC). Ce sondage a été réalisé sur une plateforme externe respectant les exigences du RGPD.
Au Burkina Faso, le cyberharcèlement est une réalité qui prend de plus en plus d’ampleur.
Le média lefaso.net a mené une enquête à cet effet.
Selon l’enquête de ce média, “300 femmes et filles ont répondu aux questions.
La Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC), une structure du gouvernement burkinabè spécialisée dans le traitement des crimes et infractions commis via les technologies numériques, a reçu 51 cas de cyberharcèlement en 2024, dont 23 femmes et 28 hommes.
Le nombre de cas chez les femmes est considérable. En effet, dans une interview sur leFaso.net , “le lieutenant de police Julien Legma affirme que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, car contrairement aux hommes, la majorité des femmes victimes n’osent pas porter plainte. Il révèle que de nombreuses créatrices de contenus sont la cible de cyberharcèlement.”
Néanmoins le nombre de cas élevé chez les hommes nous montre que les hommes sont également victimes de VBG en ligne et cela n’est pas à négliger.
Au Bénin, la situation reste préoccupante, on n’a pas de statistique claire sur les VBG en ligne. Cependant, selon le document du 5ᵉ atelier régional sur les statistiques du genre : « Utiliser les statistiques du genre pour galvaniser les actions en vue d’accélérer les progrès à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD en Afrique », Session « Mesurer les violences contre les femmes perpétrées via les technologies » par l’INSTAD le Casablanca le 10 novembre 2023.
Cette étude montre que la violence en ligne fait des victimes dans toutes les sphères de la société et cela implique tous les genres, particulièrement les femmes qui sont beaucoup plus vulnérables, plus enclines à se taire qu’à dénoncer.
Au Togo, il est difficile d’obtenir des chiffres précis et récents spécifiquement sur les violences basées sur le genre (VBG) en ligne, car les études dédiées à ce phénomène sont encore peu nombreuses. Cependant, des données contextuelles, des enquêtes régionales et des études récentes fournissent un aperçu de la situation tel que souligné ci-dessus.
Les multiples visages de la cyberviolence

La violence numérique à l’égard des femmes se manifeste sous diverses formes, toutes aussi destructrices les unes que les autres :
Le cyberharcèlement constitue la forme la plus répandue. Il se traduit par des messages d’intimidation répétés, des commentaires dégradants, des menaces ou des insultes à caractère sexiste. Les femmes actives sur les réseaux sociaux, particulièrement celles qui s’expriment sur des sujets politiques ou sociétaux, sont des cibles privilégiées. Le phénomène est si courant qu’il a donné lieu à des expressions symptomatiques comme “Va à la cuisine !”, commentaire récurrent adressé aux femmes qui osent prendre la parole sur les questions d’intérêt public. Par exemple au Burkina Faso, Yasmine Nikiéma créatrice de contenus de divertissement, reçoit parfois des commentaires dégradants sur son physique. « Grosse, patate, vache, hippopotame. »

Le revenge porn ou pornodivulgation représente une violation particulièrement grave de l’intimité. Cette pratique consiste à publier des images ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la victime, souvent dans un but de vengeance après une rupture ou un conflit. Selon Amnesty International, parmi les femmes victimes de harcèlement en ligne, 17% ont subi une divulgation de leurs informations personnelles.
Le chantage à la webcam (ou sextorsion) est une forme d’arnaque et de cyberviolence où une personne est menacée de voir des images ou vidéos intimes diffusées publiquement, sauf si elle paie de l’argent ou fait ce que le maître-chanteur demande. Au Burkina Faso, selon la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC), en 2024, 117 femmes victimes de sextorsion ont été enregistrées sur plus de 500 plaintes globales reçues avec un préjudice financier de 6 643 000 FCFA.
Selon le média Africaho, le 7 août 2024, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) a publié des données préoccupantes concernant la sextorsion au Bénin. Selon l’étude, les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène, représentant 69 % des victimes.
Le doxxing, soit la publication malveillante d’informations personnelles (adresse, numéro de téléphone, lieu de travail), expose les femmes à des dangers physiques réels et à des intrusions dans leur vie privée.
Les deepfakes pornographiques et le morphing d’images constituent des menaces émergentes, permettant de créer de fausses images compromettantes à partir de photos réelles.
Le stalking numérique ou cybersurveillance permet à des harceleurs de traquer leurs victimes à travers leurs activités en ligne, créant un sentiment d’insécurité permanent.
Les conséquences sur la vie des femmes
L’impact de ces cyberviolences dépasse largement le cadre virtuel. Les conséquences sont multiples et souvent dévastatrices :
Sur le plan psychologique, les victimes développent fréquemment de l’anxiété, des dépressions, une perte d’estime de soi et un sentiment d’insécurité permanent. Le caractère public et viral des agressions en ligne amplifie leur impact traumatique.
Sur le plan social, de nombreuses femmes choisissent l’autocensure pour éviter le harcèlement. Elles limitent leur présence en ligne, renoncent à s’exprimer sur certains sujets, voire se retirent complètement des espaces numériques. Cette auto-exclusion limite leur accès à l’information, à l’éducation numérique et aux opportunités économiques.
Sur le plan professionnel, les femmes journalistes, militantes, entrepreneures ou personnalités publiques voient leur carrière compromise. Au Burkina Faso, une étude de 2022 menée auprès de 22 femmes journalistes a révélé d’importants défis sécuritaires et professionnels liés aux violences en ligne et hors ligne.
Sur le plan économique, certaines femmes perdent des opportunités professionnelles, voient leur réputation ternie, ou doivent investir des ressources considérables pour gérer les conséquences des cyberattaques.
Les lacunes du cadre juridique
Si les trois pays ont progressé dans la reconnaissance des violences basées sur le genre, leur arsenal juridique face aux cyberviolences demeure insuffisant. À l’échelle mondiale, seules 58 économies sur 190 disposent d’une législation protégeant spécifiquement les femmes et les filles contre le harcèlement et les violences en ligne.
En 2022, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, lors de sa 72ᵉ session ordinaire, a adopté une résolution sur la protection des femmes contre la violence numérique en Afrique. Elle reconnaît que “les femmes qui accèdent à l’internet sont constamment exposées au risque de violence” et que “les États présentent toujours des lacunes dans leur cadre juridique pour protéger les femmes contre la violence numérique”.
Au Bénin, au Togo et au Burkina Faso, plusieurs défis persistent :
- L’absence de lois spécifiques criminalisant explicitement les différentes formes de cyberviolences
- Le manque de formation des forces de l’ordre et du système judiciaire aux spécificités des crimes numériques
- Les difficultés de collecte de preuves numériques
- La lenteur des procédures judiciaires
- Le coût élevé de l’accès à la justice pour les victimes
Les réponses concrètes à déployer
Face à ce constat, une approche multidimensionnelle s’impose, impliquant l’ensemble des acteurs de la société.
Renforcer le cadre juridique
Les États doivent adopter des lois spécifiques criminalisant les cyberviolences sous toutes leurs formes. Ces législations devraient :
- Définir clairement chaque type de cyberviolence (cyberharcèlement, revenge porn, doxxing, stalking numérique) ;
- Prévoir des sanctions dissuasives et proportionnées ;
- Faciliter les procédures de signalement et de plainte ;
- Protéger l’identité des victimes durant les procédures ;
- Permettre le retrait rapide des contenus préjudiciables.
Former les acteurs de la chaîne judiciaire
Les magistrats, policiers, gendarmes et avocats doivent recevoir une formation spécialisée sur :
- La nature et l’impact des cyberviolences ;
- Les techniques d’enquête numérique ;
- La collecte et la préservation des preuves digitales ;
- L’accompagnement sensible des victimes.
Créer des mécanismes de signalement efficaces
Chaque pays devrait mettre en place :
- Des lignes d’assistance téléphonique dédiées ;
- Des points focaux dans les commissariats et gendarmeries ;
- Des procédures simplifiées ne nécessitant pas de déplacements physiques systématiques.
Responsabiliser les plateformes numériques
Les réseaux sociaux et plateformes en ligne doivent être contraints à :
- Modérer plus efficacement les contenus violents ;
- Répondre rapidement aux signalements ;
- Collaborer avec les autorités judiciaires ;
- Développer des outils de protection pour les utilisatrices ;
- Publier des rapports de transparence sur le traitement des cyberviolences.
Sensibiliser et éduquer
Des campagnes massives de sensibilisation doivent cibler :
- Le grand public sur les conséquences des cyberviolences ;
- Les hommes et les garçons sur les masculinités positives et le respect en ligne ;
- Les jeunes dans les établissements scolaires sur la citoyenneté numérique ;
- Les professionnels des médias sur un traitement éthique des cyberviolences.
Accompagner les victimes
Un réseau de soutien doit être développé, incluant :
- Des centres d’écoute et d’accompagnement psychologique ;
- Une assistance juridique gratuite ou à coût réduit ;
- Des services de soutien technique pour sécuriser les comptes et retirer les contenus ;
- Des programmes de réinsertion professionnelle pour les victimes gravement impactées ;
- Des groupes de soutien et d’entraide entre survivantes.
Promouvoir l’éducation numérique
L’alphabétisation numérique doit intégrer :
- La sécurité en ligne et la protection de la vie privée ;
- La gestion des paramètres de confidentialité ;
- La reconnaissance des signes avant-coureurs de cyberviolence ;
- Les stratégies de réponse et de protection ;
- Les droits numériques des femmes.
Encourager la recherche et la documentation
Il est essentiel de :
- Produire régulièrement des données statistiques fiables ;
- Mener des études qualitatives sur l’impact des cyberviolences ;
- Documenter les bonnes pratiques et les initiatives réussies ;
- Partager les connaissances entre les trois pays et au-delà.
Favoriser la solidarité régionale
Le Bénin, le Togo et le Burkina Faso gagneraient à :
- Harmoniser leurs législations sur les cyberviolences ;
- Créer un observatoire sous-régional des violences numériques ;
- Partager les expertises et les ressources ;
- Développer des campagnes de sensibilisation communes ;
- Faciliter l’entraide judiciaire transfrontalière.
Mobiliser le secteur privé
Les entreprises technologiques locales, les start-ups et les opérateurs télécom doivent être impliqués dans :
- Le développement d’applications de protection ;
- Le financement de programmes de sensibilisation ;
- La formation des utilisateurs ;
- L’innovation en matière de sécurité numérique.
Des initiatives inspirantes
Plusieurs initiatives méritent d’être soulignées et reproduites. L’organisation Internet Sans Frontières a mené en 2019 des campagnes de sensibilisation sur les cyberviolences en Afrique de l’Ouest.
Au Bénin, l’association Biowa, soutenue par l’ONG CARE, développe des programmes innovants de lutte contre les violences basées sur le genre.
UNFPA Benin et Les Affaires Mondiales du Canada ont organisés une session pilote de formation de 3 jours à Cotonou avec pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de première ligne, des institutions, des OSC et des jeunes leaders pour mieux prévenir, détecter et répondre aux VBG facilitées par les technologies du numérique.
L’association Cyber221 basée au Sénégal à travers son programme ambassadeur numérique déployé dans plusieurs pays africains, notamment le Burkina, mène des campagnes de sensibilisation digitale et des webinaires sur la cyberviolence.
L’association Women in Cybersecurity, chapitre Ivory Coast/Burkina Faso, à travers son engagement dans la promotion des femmes dans les STEM et la cybersécurité, initie des formations en cybersécurité pour les femmes.
Un symbole fort pour démystifier la sécurité numérique et valoriser le leadership, l’inclusion des femmes cyber.

Des projets de formation à la sécurité numérique spécifiquement destinés aux femmes se multiplient, proposant des guides pratiques et des ateliers sur la protection en ligne.
La BCLCC a mis en place une plateforme de signalement des violences en ligne et tout type de cybercriminalité nommée Alerte BCLCC , pour lutter efficacement contre les dérives en ligne.
Ces initiatives démontrent qu’avec des ressources et une volonté politique, il est possible de créer un environnement numérique plus sûr.
L’enjeu dépasse la simple protection des femmes en ligne !
Les violences basées sur le genre à l’ère du numérique constituent un défi majeur pour le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Elles menacent non seulement le bien-être et la sécurité des femmes, mais également les progrès vers l’égalité de genre et le développement inclusif de la sous-région.
La lutte contre ces violences exige une mobilisation sans précédent de tous les acteurs : États, société civile, secteur privé, médias, communautés et individus. Elle nécessite une approche combinant législation, répression, prévention, éducation et accompagnement.
Il s’agit de garantir que la révolution numérique, loin d’être un espace de reproduction des inégalités et des violences, devienne un levier d’émancipation et de participation pleine et entière des femmes au développement de nos sociétés.
Le combat est long, mais chaque action compte. Chaque loi adoptée, chaque plateforme sécurisée, chaque victime accompagnée, chaque harceleur sanctionné, chaque jeune sensibilisé représente un pas vers un monde numérique où les femmes pourront s’exprimer, créer, entreprendre et participer librement, sans crainte de violence ou de représailles.
L’avenir numérique de l’Afrique de l’Ouest se construira avec les femmes, il est temps d’agir, ensemble pour que cette promesse devienne réalité.
Bibliographie
https://www.bbc.com/afrique/articles/cm20jjl6j8yo
https://lefaso.net/spip.php?article140056
Auteure : Balkiss OUEDRAOGO
Cette publication WanaData a été soutenue par Code for Africa et la Digital Democracy Initiative dans le cadre du projet Digitalise Youth, financé par le Partenariat Européen pour la Démocratie (EPD).